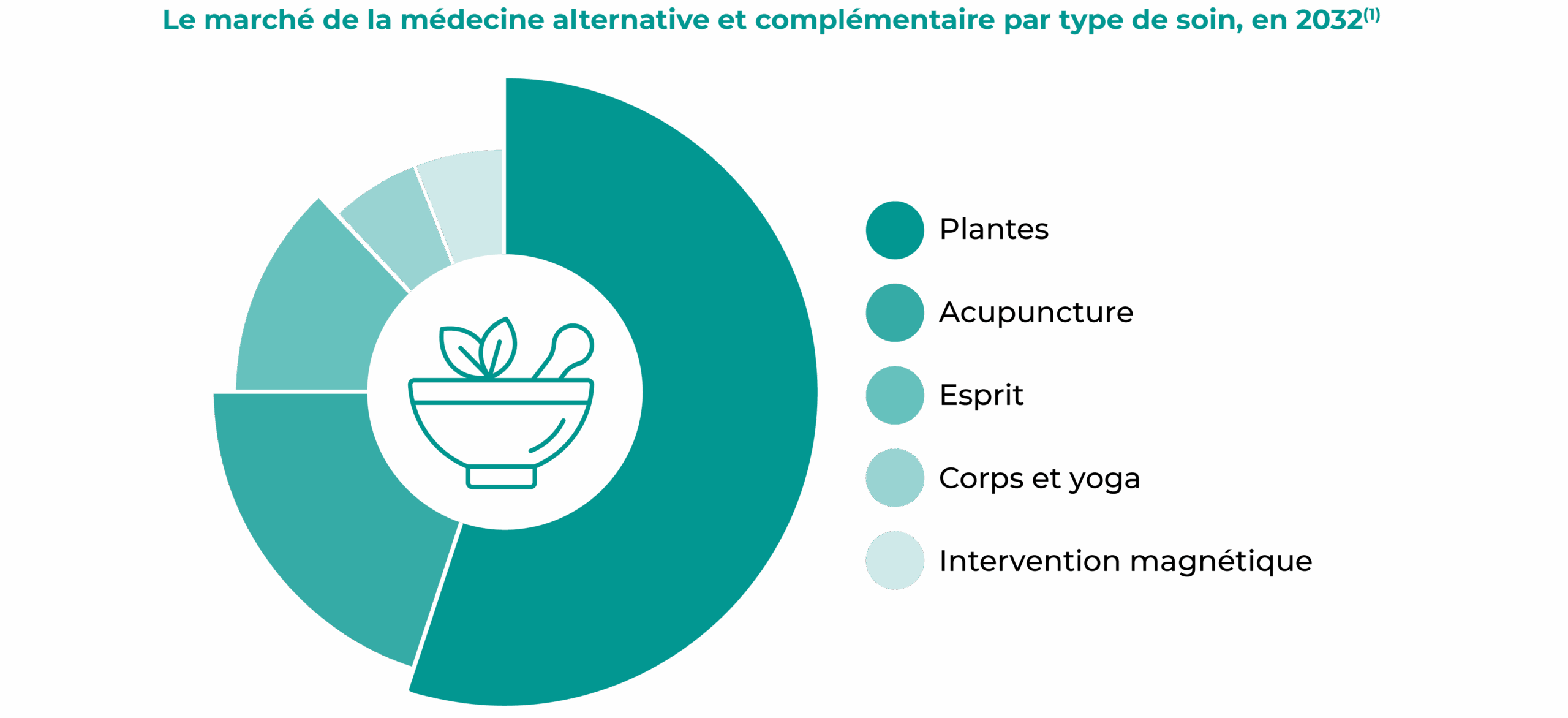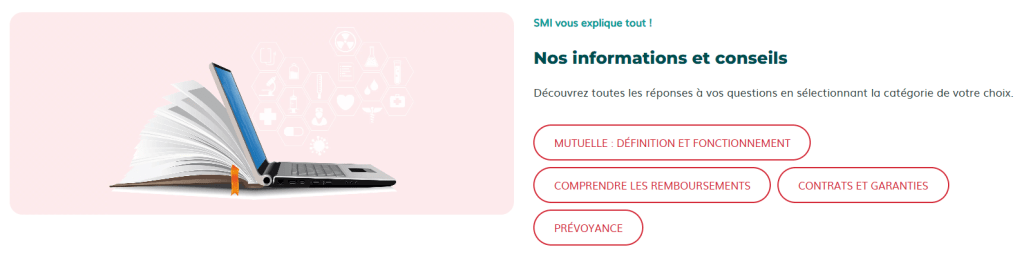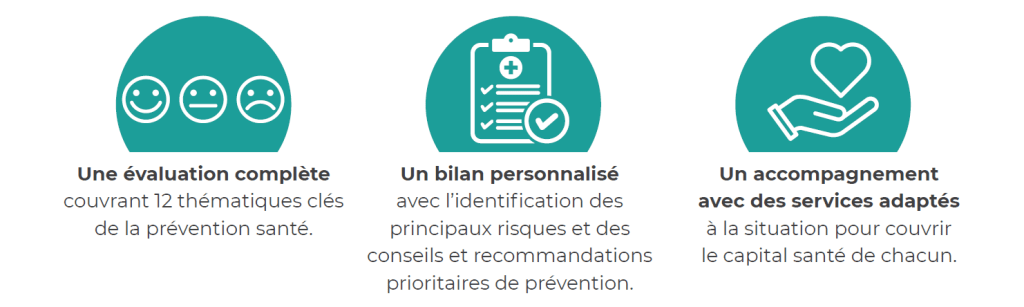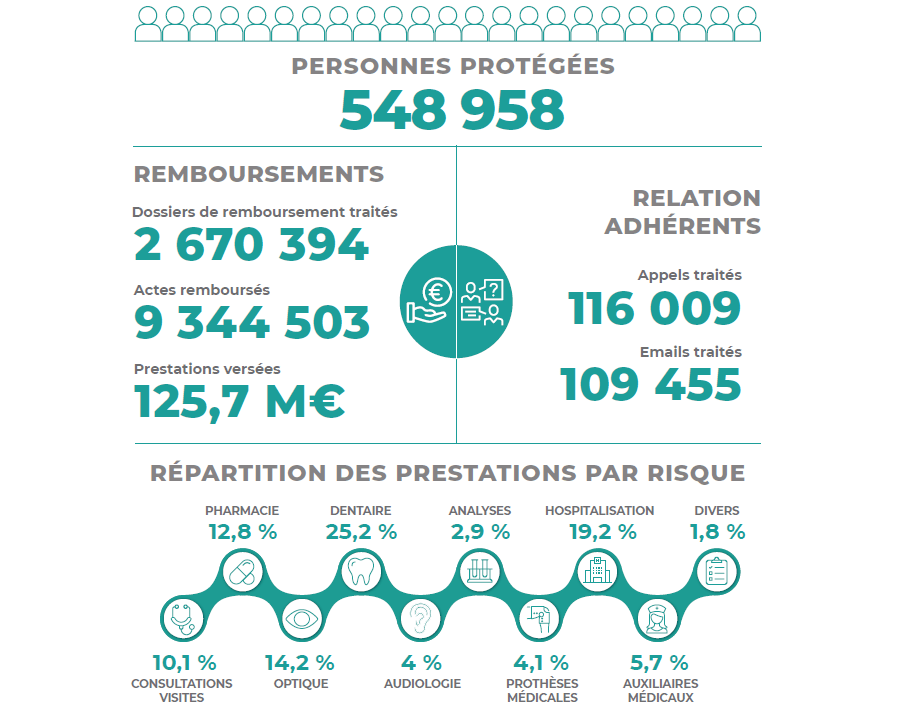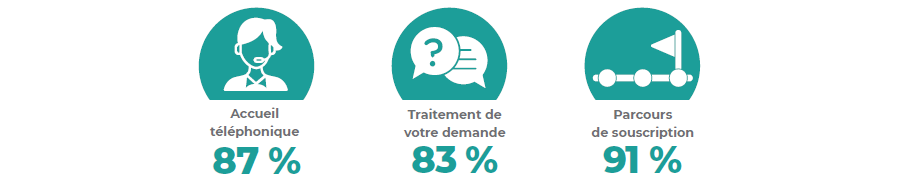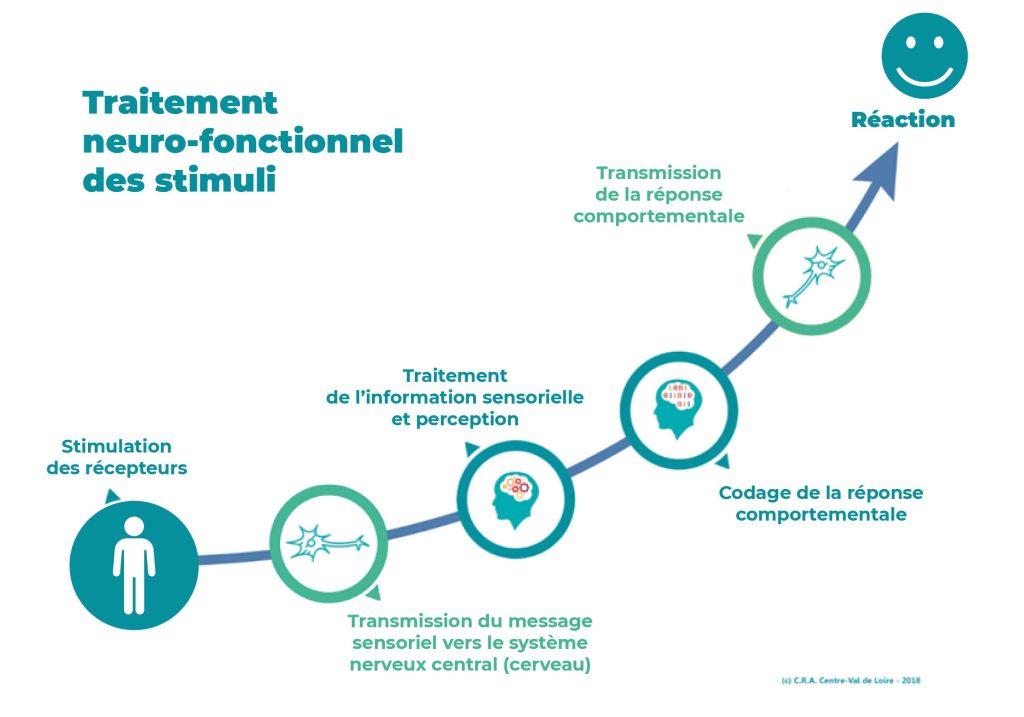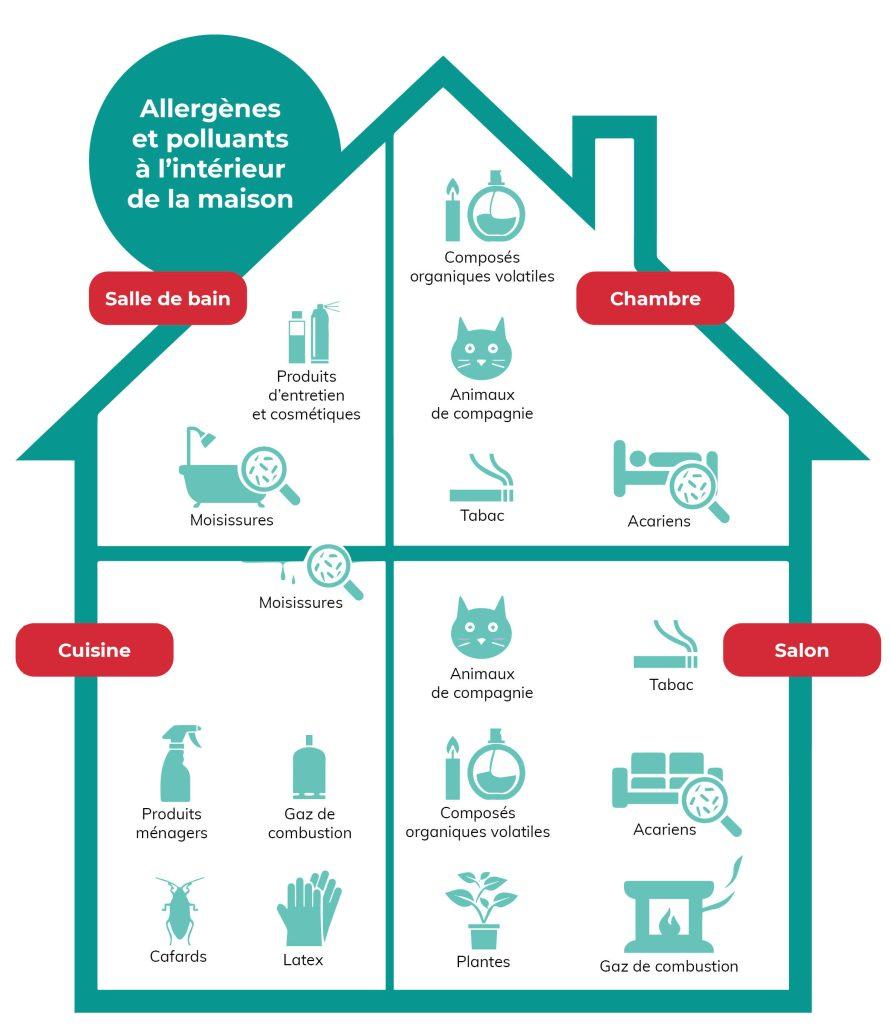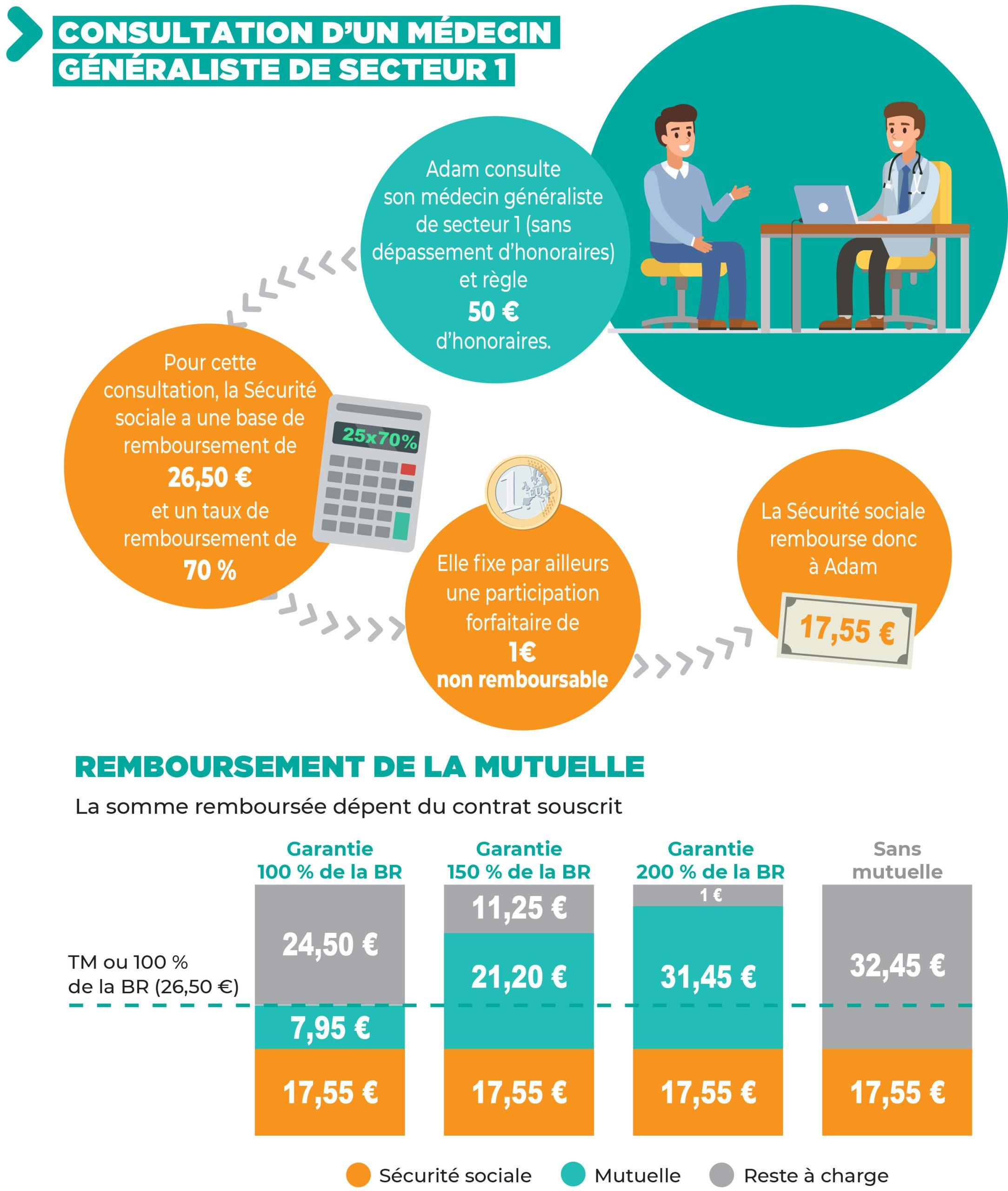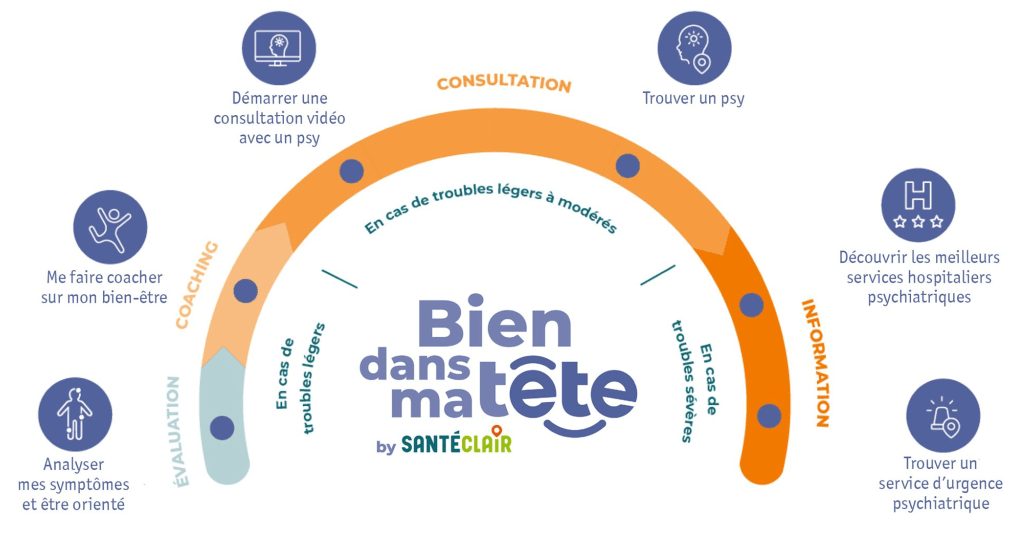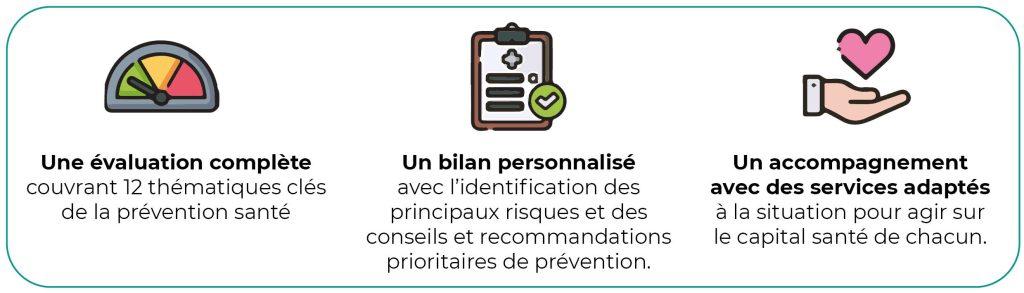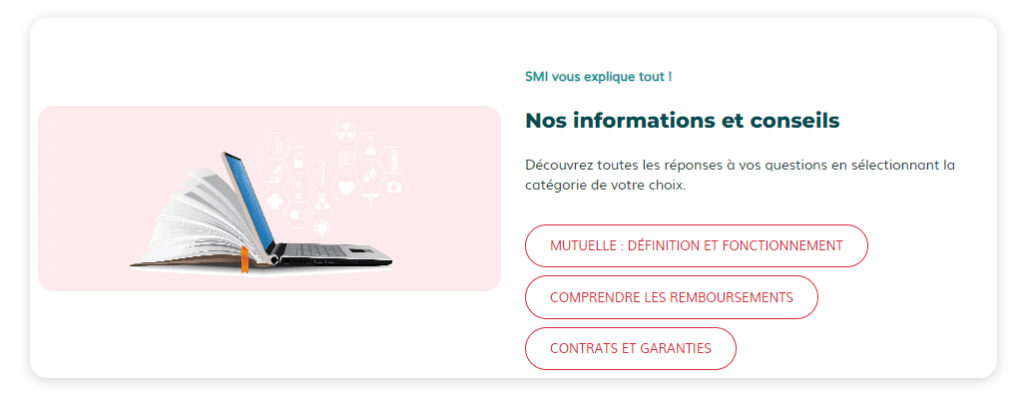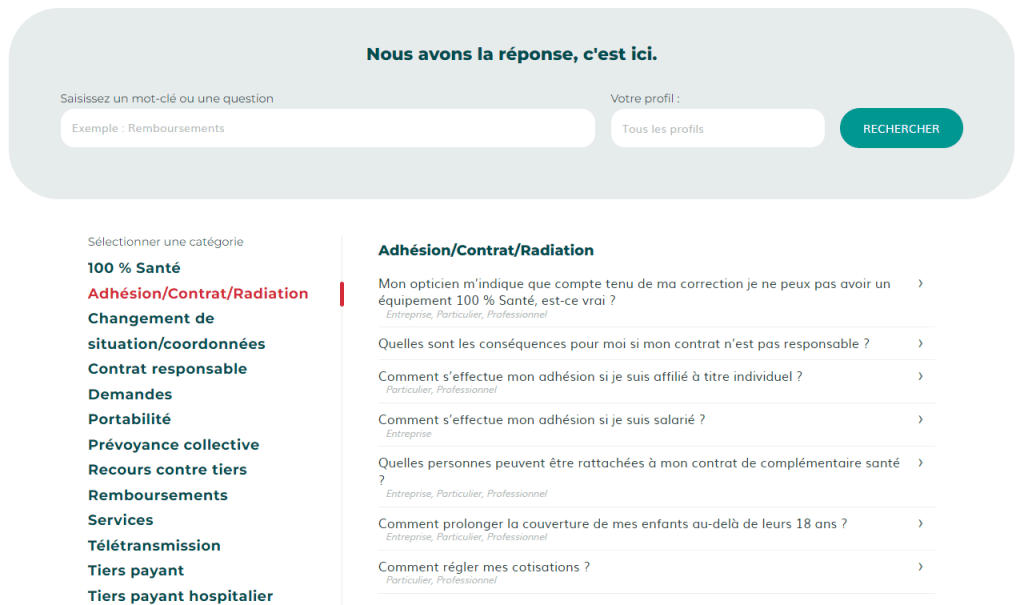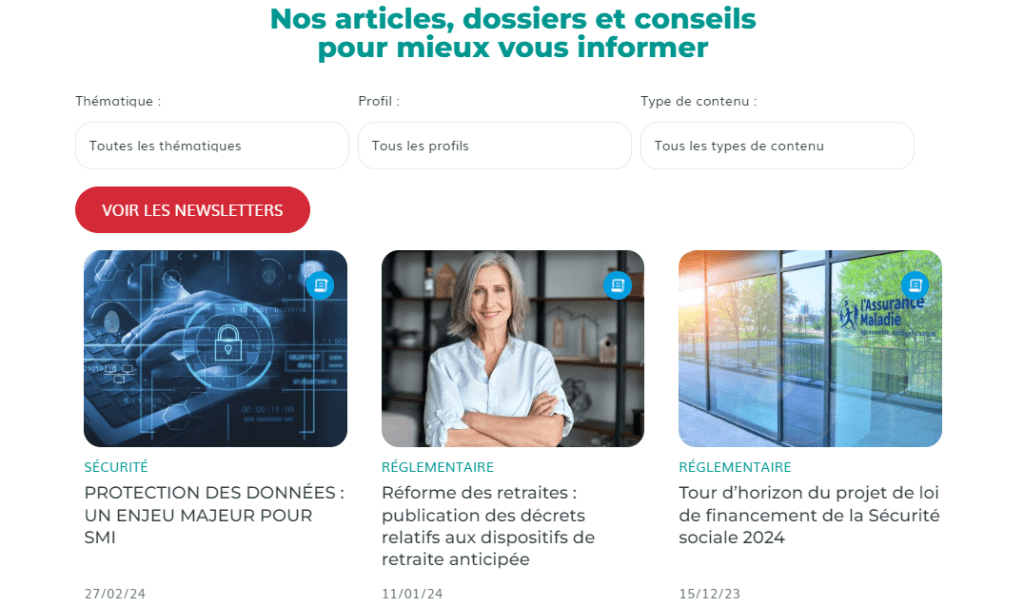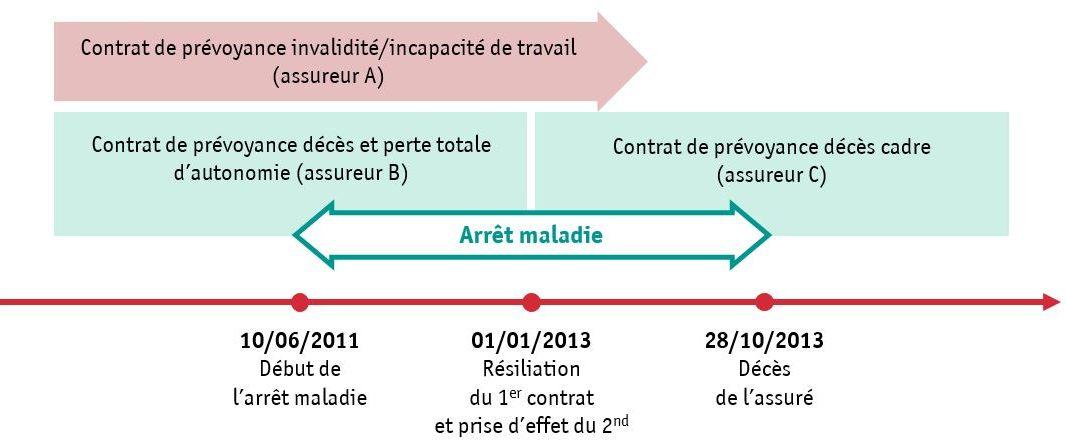Que réserve le PLFSS 2024 ? Voici un tour d’horizon des principales mesures contenues dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, susceptibles d’impacter le secteur complémentaire.
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2024 a été déposé auprès de l’Assemblée Nationale le 27 septembre 2023, avant d’être transmis au Sénat pour examen.
Le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur ce texte en application de l’article 49-3 de la Constitution. Après rejet des différentes motions de censure déposées, le texte est considéré comme adopté par l’Assemblée Nationale au 4 décembre 2023.
Le Conseil constitutionnel, saisi le même jour, doit encore se prononcer sur la conformité de ses dispositions à la Constitution.
Principales dispositions issues du PLFSS 2024
Annulation du transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco à l’Urssaf
Initialement prévu par la LFSS de 2020, ce transfert est annulé par le PLFSS pour 2024.
Ces deux organismes devront toutefois assurer une réponse unifiée aux questions juridiques qui leur sont communes.
Prise en charge des frais de vaccination
La prise en charge intégrale par l’AMO des frais d’acquisition du vaccin contre les papillomavirus (HPV) est prévue, au bénéfice des personnes vaccinées dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination en milieu scolaire ou au sein d’établissements médico-sociaux.
Le ticket modérateur du vaccin contre la grippe sera supprimé, pour les personnes dont la vaccination est recommandée par le calendrier vaccinal.
Enfin, le ticket modérateur du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole sera supprimé, au bénéfice des mineurs.
Prise en charge de protections hygiéniques réutilisables
Le remboursement partiel de protections hygiéniques réutilisables est institué, au bénéfice des femmes âgées de moins de 26 ans. Une prise en charge complémentaire par les Ocam est prévue.
La prise en charge intégrale par l’AMO de l’achat de ces protections est prévue pour les femmes bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, sans limitation d’âge.
Parcours de soins coordonnés renforcés
Ces expérimentations issues de l’article 51 de la LFSS pour 2018 entrent dans le droit commun.
Il s’agit de financer de façon collective une équipe adaptée aux besoins du patient, pouvant se déployer entre la ville, l’hôpital et le secteur médico-social.
Ce financement sera assuré via un forfait réparti entre les acteurs du parcours. La participation de l’assuré devra être fixée par arrêté et fera l’objet d’une prise en charge par les Ocam.
Élargissement de la compétence des pharmaciens
Pour les cas d’angine ou de cystite simple, les pharmaciens pourront procéder aux Tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) et délivrer le traitement approprié (y compris antibiotique), sans ordonnance.
Contrôle des arrêts maladie
- Faculté de suspension par le service du contrôle médical du versement d’indemnités journalières maladie. Cette suspension pourra intervenir si le contrôle effectué par le médecin sur demande de l’employeur conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail (ou de sa durée). Le médecin contrôleur dispose désormais de 72 heures pour transmettre son rapport au service de contrôle de la caisse médicale. La suspension est effective à la date où l’assuré est informé de la décision de suspension, ou à la date de fin d’arrêt retenue par le médecin s’il décide de l’écourter. L’assuré pourra contester cette décision auprès du service de contrôle médical.
- Le versement d’indemnités journalières pourra être subordonné à l’accord préalable du service du contrôle médical. Cette disposition vise les centres de santé comme les sociétés de téléconsultation. Ce contrôle préalable pourra être instauré en cas de non-respect de la législation régissant le constat de l’incapacité de travail, ou en cas de ratio anormal entre la longueur et la quantité des arrêts de travail prescrits par rapport à la moyenne nationale ou régionale. La durée de cette exigence de contrôle préalable ne pourra excéder six mois.
Contrôle de la pratique de la télémédecine
- Plafonnement de la durée de l’arrêt. L’arrêt prescrit en télémédecine verra sa durée plafonnée à trois jours, sauf s’il est prescrit par le médecin traitant ou si l’assuré justifie de l’impossibilité de consulter un médecin autrement.
- Déremboursements. Seront déremboursés les actes, produits et prestations prescrits en l’absence d’échange oral entre le patient et le prescripteur.
Incitation au recours au transport sanitaire partagé
En cas de refus de recours au transport sanitaire partagé compatible avec l’état de santé du patient, celui-ci verra la prise en charge de ses frais minorée. Cette minoration ne pourra pas être prise en charge dans le cadre du contrat responsable. Enfin, le tiers payant ne pourra pas être appliqué.
Repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant
Ce parcours de repérage sera fondé sur une collaboration entre différents professionnels de santé, libéraux ou en établissement de santé, ainsi qu’avec les structures médico-sociales.
La participation de l’assuré sera définie par arrêté et fera l’objet d’une prise en charge par les OCAM.
Principaux amendements retenus dans le projet de loi
Quelques amendements introduits dans le cadre des débats parlementaires méritent d’être relevés.
Suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie faisant suite à une interruption médicale de grossesse
Les trois jours de carence seront supprimés en cas d’arrêt maladie faisant suite à une interruption médicale de grossesse. Les IJSS seront donc versées dès le premier jour d’arrêt.
L’interruption médicale de grossesse vise les cas dans lesquels la grossesse est interrompue en raison du péril grave à la santé de la femme, ou de la probabilité que l’enfant naisse atteint d’une affection particulièrement grave reconnue comme incurable.
Limites d’exonération de cotisations patronales maladie et allocations familiales
Les plafonds de rémunération éligible aux exonérations au titre des cotisations patronales d’Assurance maladie et allocations familiales sont révisés. Leur valeur, fixée par décret, ne pourra être inférieure à 2,5 et 3,5 SMIC en vigueur au 31 décembre 2023.
Cette mesure aura pour effet de permettre au gouvernement de limiter à ces montants les exonérations octroyées, là où ils font aujourd’hui l’objet de revalorisation selon les évolutions du SMIC en vigueur.
Ouverture de la possibilité d’un remboursement intégral des fauteuils roulants dans le cadre du « 100% Santé »
L’article L. 165-1 du code de la Sécurité sociale, qui définit la liste des produits et prestations remboursables par l’AMO, est modifié par amendement de manière à ouvrir la voie au remboursement intégral des fauteuils roulants inscrits sur cette liste dans le cadre du dispositif « 100% Santé ».
Cette extension du dispositif « 100% Santé » aux fauteuils roulants devra être concrétisée, dans son principe et ses modalités, par un texte ultérieur.
Enfin, d’autres mesures d’une moindre importance pour notre activité ont été retenues dans le projet de loi :
- le cannabis thérapeutique se voit accorder un « statut temporaire » de cinq ans en attente d’une décision d’autorisation de mise sur le marché au niveau européen ;
- les pharmaciens pourront délivrer des médicaments à l’unité en cas de pénurie ;
- les professionnels de santé du milieu scolaire pourront orienter les victimes de harcèlement vers le dispositif « monpsy » ;
- un délit de promotion de la fraude sociale est créé.
À noter : Les mesures présentées ci-dessus ne sont pas définitives : le Conseil constitutionnel, saisi du projet de loi, peut en écarter certaines.